
| "L’homme noir". Pierre van Zuylen en het Belgisch Buitenlands Beleid 1930-1945. (Mathieu Magherman) |
| home | lijst scripties | inhoud | vorige | volgende |
Bijlagen
1. Foto’s

Baron Pierre van Zuylen[1058]

Van links naar rechts: Fernand Vanlangenhove, Jacques Davignon, Pierre van
Zuylen, Pol le Tellier,
André Kerchove de Denterghem, Léon Nemry, Paul-Henri
Spaak en Cartier de Marchienne.[1059]
2. Diplomatiek testament [1060]
Le Roi et la politique d’indépendance
Certains milieux en Belgique font le procès de la politique d’indépendance, veulent y découvrir la source de nos malheurs et s’en prennent spécialement au Roi, dénoncé comme le fatal artisan de cette politique.
Il n’est pas surprenant certes qu’au milieu des calamités qui accablant les pays, des esprits troublés ou aigris cherchent une explication des infortunes publiques dans les fautes d’autrui. Encore, convient-il de garder dans la critique un certain sans des réalités. Il serait évidemment absurde de prétendre que la Belgique ou ses chefs eussent une responsabilité quelconque dans la catastrophe qui s’est abattue sur le monde. Il serait non moins ridicule de soutenir qu’un petit pays comme le nôtre, eu été de taille à conjurer cette catastrophe ou en modifier le cours. Ce sont les décisions des grandes Puissances qui ont provoqué les évènements; ce sont leurs faiblesses et leurs erreurs qui ont donné à la guerre sa tournure actuelle. Les petits Etats ont été emportés comme fétus de paille par le torrent dévastateur.
Si l’on prétend malgré tout demander des comptes aux Etats petits et moyens et rechercher si, à défaut d’échapper à des maux inéluctables, une autre conduite leur eut permis de les atténuer ou de mieux y faire face, il importe de se souvenir que dans un pays strictement et jalousement constitutionnel comme la Belgique, le Souverain ne peut rien sans le concours des Ministres et du Parlement. Il a agi en parfaite communion d’idées et de sentiments avec eux et avec son peuple et l’on se demande à quoi riment les reproches qui, s’ils étaient justifiés, devraient retomber sur la communauté tout entière.
Il n’est pas inutile cependant d’examiner si la politique d’indépendance mérite vraiment les anathèmes que certains lui jettent ou si par-là on ne s’efforce pas seulement d’ébranler le crédit d’un Chef qui gêne certaines ambitions ou contrecarre des desseins dangereux pour le pays.
La politique d’indépendance est née des évènements qui ont suivi la guerre 1914-1918: il n’est pas possible de la comprendre sans remonter à cette époque et rappeler, brièvement au moins, les grands faits qui ont déterminé la structure de l’Europe, commandé le jeu des alliances et amené la Belgique à prendre position. Tout en obéissant aux lois propres a sa géographie et à ses traditions, un pays subit nécessairement le contrecoup des évènements, qui se passent autour de lui. Sa conduite est influencée par le jeu des actions et réactions des puissants voisins. Nous l’exposerons à grands traits.
La grande guerre avait détruit le savant équilibre des forces sur lequel reposait auparavant l’Europe. Devant les ruines accumulées et les troubles causés par l’écroulement de Empires allemand, autrichien, ottoman et russe, un grand besoin d’ordre et de sécurité travaillait les peuples. Pour assurer désormais la tranquillité du monde, les Anglo-saxons, et plus spécialement le Président Wilson avaient imaginé une Ligue des Nations qui devait à la fois maintenir le nouvel état territorial établi par les Traités et y apporter, au cours des temps, les retouches que les circonstances conseilleraient d’y introduire.
Ce système répondait aux préoccupations des Américains et des Anglais dont les possessions ou les intérêts sont disséminés sur toute la surface du globe. Il leur convenait, en outre, parce qu’il ne comportait pas d’alliance directe qui liât leur politique sur un plan déterminé. Il leur paraissait, au surplus, très suffisant, au point de vue de leur sécurité qui résultait à la fois de la puissance de leurs flottes et de la ceinture des mers qui les garantissaient contre une attaque brusquée.
Il n’en était pas de même des Etats du Continent dont le territoire avait été sis souvent le théâtre des conflits armés. Tel était le cas, tout particulièrement, de la France et de la Belgique.
Tout en acceptant le nouvel aréopage qui devait se substituer au vieux système d’équilibre et d’alliance, ces pays désiraient compléter les garanties encore neuves et non éprouvées, de la Ligue par des sûretés plus rapides et plus tangibles.
La Belgique, qui avait renoncé à la neutralité des Traités de 1839 parce qu’elle n’avait pu la défendre contre l’invasion et lui faisait un statut d’Etat mineur, demandait, pour se préserver à l’avenir; de meilleures frontières et une promesse d’assistance franco-anglaise. L’opinion encore dominée par le ressentiment de l’occupation allemande et la hantise de son retour, n’aspirait qu’à la consolidation des liens noués pendant la guerre et des constellations provisoires qu’elle avait créées et qu’on croyait permanentes. Personne ne songeait plus à l’attitude d’impartialité que les Traités avaient consacrée mais que la tradition nous avait léguée comme conséquence de notre position géographique et de la faiblesse de nos forces.
La France cherchait sa sécurité, en même temps que le maintien de la prépondérance militaire que lui avait apportée la victoire, dans la constitution d’une forte barrière sur le Rhin et la conclusion d’un pacte défensif avec l’Angleterre et les Etats-Unis. Le Traité de Versailles avait donné la barrière, en stipulant pour Quinze ans l’occupation des territoires rhénans par les alliées et en interdisant pendant une période illimitée à l’Allemagne d’entretenir des troupes dans ces régions et de les fortifier. Par un accord spécial et séparé, l’Angleterre et les Etats-Unis promettaient leur assistance à la France en cas d’agression allemande. La Belgique voyait sa sécurité assuré directement par cette barrière et indirectement par le Pacte anglo-américain, on bénéfice auquel nous étions associes par une lettre annexe. Malheureusement les Etats-Unis refusèrent de ratifier l’accord comme le Traité de Versailles. L’Angleterre retira sa promesse et le Pacte défensif tomba. Chose plus fâcheuse encore, les Etats-Unis ne participèrent pas à la Ligue des Nations qui en fut ainsi affaiblie dès l’origine.
La France s’arrangea alors pour se couvrir autrement: Elle noua en Europe un réseau d’accords militaires avec des Etats qui se considéraient comme menacés par l’Allemagne, tels la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie Serbie. Elle offrit un arrangement de ce genre à la Belgique. Celle-ci eût préféré une garantie franco-anglaise, parce que plus efficace et parce qu’assurant mieux la liberté de son action. Mais l’Angleterre n’offrait qu’une garantie de cinq ans, c’est-à-dire pour une période pratiquement sans danger et elle exigeait de la Belgique le retour à la neutralité. Bruxelles n‘insista pas et accepta l’offre française, et ce fut l’accord militaire de 1920.
Les deux pays n’abandonnaient cependant pas l’espoir d’une entente avec Londres: la Belgique, parce qu’elle sentait son indépendance compromise par des liens exclusifs avec la France; la France, parce qu’elle comprenait que l’appui de ses alliés mineurs ne remplaçait pas celui d’une grande puissance comme l’Angleterre, que sa politique retrouvait partout sur son chemin. Ses efforts furent longtemps inutiles.
L’Angleterre avait ses raisons de refuser satisfaction à la France: elle avait fait la guerre en 1914 pour empêcher l’établissement d’une hégémonie allemande sur le Continent. L’Allemagne abattue, elle craignait que ne s’y substituât une hégémonie française. Elle allait, pour rétablir l’équilibre, aider au relèvement de l’Allemagne et à l’abaissement de la France. Une autre raison du refus anglais c’est que la France ne réclamait pas seulement l’assistance britannique dans le cas d’une attaque contre le sol français, elle voulait aussi cette assistance dans l’éventualité où les alliés de la France, Pologne, Tchécoslovaquie etc. seraient l’objet d’une agression allemande. L’Angleterre n’entendait pas prendre des risques si étendus, d’autant plus qu’elle estimait que les frontières de plusieurs de ces Etats assez arbitrairement tracées à Versailles étaient de nature à provoquer des conflits. Enfin, et surtout, les politiques de la France et de l’Angleterre s’opposaient ou se heurtaient en de nombreux domaines: question du désarmement, des réparations, problème des sous-marins, affaire de Turquie, d’Asie Mineure etc…L’Angleterre, préoccupée du relèvement de ses exportations et de son commerce, s’irritait de voir la France traverser ses desseins en Allemagne et en Russie par une application rigide des Traités. L’affaire de la Ruhr approfondit le fossé entre les deux Etats et l’on vit alors l’Angleterre prendre nettement le parti de l’Allemagne contre la France.
L’Allemagne dût capituler, mais la France affaiblie financièrement par la pression anglo-américaine et politiquement par le triomphe des gauches dût à son tour composer avec Londres. Un compromis fut trouvé: c’était le Pacte de Locarno. Par ce pacte, l’Angleterre et l’Italie promettaient leur assistance à la France et à la Belgique en cas d’agression non provoquée de l’Allemagne. Mais elles s’engageaient à prêter la même assistance à l’Allemagne si celle-ci était attaquée par la France. Ce n’était pas l’alliance anglaise rêvée par la République à Versailles, mais un Traité d’équilibre où l’Angleterre bridait à la fois la France et l’Allemagne et rétablissait à son profit la balance du pouvoir. Un nouvel équilibre européen s’était créé.
Ce traité replaçait la Belgique dans une situation d’impartialité analogue à celle des Traités de 1839, avec cette différence que la Belgique n’était plus neutre et que garantie elle était en même temps garante. L’accord défensif avec la France était résorbé par Locarno et ne pouvait jouer que dans des conditions fixées à Locarno.
Le Pacte rhénan assurait certes la défense de la Belgique en cas d’agression, mais elle lui imposait en contrepartie une assez lourde charge, c’était de contribuer à la défense de ses grands voisins, la France et l’Allemagne. Comment se justifiait cet accroissement de responsabilités et ce concours de la Belgique au maintien de la sécurité occidentale? Il n’est pas superflu de le rappeler.
Tout d’abord, le Pacte de Locarno avait confirmé et consolidé les clauses de Traité de Versailles qui établissaient la barrière rhénane et l’interdiction pour l’Allemagne d’y établir des troupes et des forteresses. Tant que ce glacis rhénan subsisterait, la frontière défensive de la Belgique était reportée plus à l’Est et son sol mieux protégé. Cela était d’autant plus vrai que cette défense avancée serait désormais assurée, non plus seulement par la France et de la Belgique mais encore par l’Angleterre et l’Italie. Ensuite, le Pacte de Locarno était étroitement lié à l’application du Covenant de la Société des Nations. L’intervention de la Belgique, comme celle des autres Locarniens, était subordonnée à la décision du conseil de la Société des Nations et, par le fait même, nous pouvions compter légitiment sur le concours de la Ligue en cas d’action. Si nos risques étaient accrus, nos garanties étaient augmentées dans une proportion plus grande encore. Enfin, un autre facteur, psychologique velui-là, influa également sur nos décisions. La dislocation des alliances de guerre, les luttes d’intérêt qui avaient repris entre les Puissances, les inconvénients ressentis d’un accord trop étroit avec la France, avaient amené une évolution en Belgique et incliné à nouveau les esprits vers un retour à la politique traditionnelle d’impartialité.
Ainsi s’explique et la décision de nos Gouvernants et l’adhésion enthousiaste de notre opinion publique à ce Pacte. Un sentiment également favorable de notre opinion publique à ce Pacte. Un sentiment également favorable se répandit en Europe. Car aux avantages matériels qu’apportait Locarno s’ajoutait un bénéfice moral plus important encore: ce Pacte était le signe d‘une réconciliation franco-allemande et un rapprochement entre la France, l’Angleterre et l’Italie. L’atmosphère de pacification générale, dans lequel il était conclu, faisait augure une ère de paix et de prospérité. Si Locarno ne donna pas tous les fruits qu’on en espérait, ce ne fut certes pas la faute de la Belgique qui ne cessa pendant les dix années de sa durée, de lui prêter sa collaboration la plus fidèle et la plus loyale. Mais un concours de circonstances funestes, dû aux querelles renouvelées de grandes puissances allait miner à peu l’édifice et en précipiter.
Ce fut d’abord la dispute qui s’éleva entre les Etats désarmés par les Traités et leurs vainqueurs, au sujet de la réduction des armements. Les premiers s’appuyant sur l Préambule du Covenant prétendaient obliger les seconds à diminuer leur force militaire ou bien à permettre aux vaincus de réarmer à un niveau à peu près égal à celui des vainqueurs. Cette discussion s’éternisant sans résultat, les Etats désarmés commencèrent à reconstituer leurs forces en secret d’abord, puis ouvertement, en revendiquant l’égalité de traitement. Cette violation des Traités provoqua des protestations bruyantes chez les vainqueurs, mais ces protestations ne s’accompagnaient d’aucun acte, il n’en fut pas tenu compte. L’inquiétude amena toutefois chez les anciens vainqueurs à renforcer leurs moyens de guerre. Les autres Etats, alarmés à leur tour, suivirent l’exemple et ce fut la course générale aux armements.
Cette situation, sérieuse en soi, était malheureusement aggravée par une diminution de l’autorité de la Société des Nations. Ebranlée à ses débuts par l’abstention des Etats-Unis, la Société fut encore affaiblie par la façon restrictive dont certaines grandes Puissances interprétaient leurs devoirs Covenantaires. L’Angleterre, notamment, ne cachait pas sa volonté de proportionner son concours à la Ligue, à la mesure de ses intérêts. Cette politique égoïste fut bientôt suivie par un grand nombre d’autres Etats causa l’avortement des plans de sécurité élaborés par la Société des Nations. Cette fuite devant les responsabilités allait avoir de plus graves conséquences. La Société des Nations faillit à sa mission pacificatrice, lors des conflits qui s‘élevèrent en Amérique, à propos du Chaco, et en Asie, entre le Japon et la Chine. Un échec plus retentissant encore allait lui être infligé dans l’affaire d’Abyssinie où l’Italie puit braver impunément les foudres de Genève parce que les Sociétaires ne purent ou n’osèrent appliquer à fond les sanctions prévues par le Pacte. Cette fois le crédit de la Ligue était ruiné, car que pouvait-on espérer d’elle dans les cas où au lieu d’avoir affaire à une grande Puissance de second ordre, comme l’Italie, il s’agirait de mettre à la raison d grandes Puissances de premier ordre, comme l’Allemagne ou la Russie. L’affaire d’Abyssinie eut des suites plus fâcheuses encore, en faisant de l’Italie une ennemie de l’Angleterre et de la Société des Nations et une alliée de l’Allemagne. Cette fois c’était le Pacte de Locarno qui était atteint à son tour et la sécurité occidental, mise en péril. Comme nous l’avons vu plus haut, Locarno était un traité d’équilibre, grâce auquel un conflit franco-allemand était rendu presque impossible par la coalition contre l’agresseur des forces des autres contractants. Du moment où l’Italie passait au camp allemand, le jeu u Pacte était faussé. On le vit bien quand l’Allemagne décida en 1936 de déchirer le Traité et de réoccuper militairement le territoire rhénan en affirmant que l’alliance franco-russe portait atteinte à l’esprit du Pacte.
En présence de cette violation qui la touchait à la fois dans ses (?) et ses intérêts les plus essentiels, la Belgique se rangea au côtés de la France et de l’Angleterre pour protester tout d’abord contre l’attitude de l’Allemagne et tâcher de rétablir le statu quo ante. La France avait manifesté, en premier lieu, des velléités d’opposer la force à la force, mais elle ne voulait pas agir sans l’assistance de l’Angleterre. Celle-ci non seulement déclina tout concours militaire, mais elle admit l’opportunité de réviser le Traité en faveur de l’Allemagne en renonçant à tout ou en partie de la démilitarisation rhénane, qui était un des éléments vitaux du Pacte. La Société des Nations, consultée sur le conflit, se borna à constater la violation commise, mais se déroba à toute action, laissant aux Parties le soin de négocier entre elles un arrangement. Ce nouvel arrangement lui-même ne pût se réaliser, en raison de la division qui régnait entre Français et Anglais d’une part, et Allemands et Italiens d’autre part.
Que devait faire la Belgique au moment où il apparaissait que ce Traité nouveau ne pouvait voir le jour?
Rester aux côtés de la France et de l’Angleterre ou reprendre sa liberté? Rester aux côtés de la France et de l’Angleterre, ce n’était pas comme certains l’ont cru, continuer la politique de Locarno, qui était une politique d’équilibre et de paix entre cinq Puissances. C’était renoncer à une politique d’impartialité pour nouer une politique d’alliance et cela au moment où l’Europe se divisait en deux camps et où les revendications des Etats vaincus s’accompagnant du bruit des armements faisaient présager une lutte prochaine.
C’était aussi risquer d’être entraînés dans les guerres qui pourraient surgir des querelles entre la France et l’Allemagne, mais également des conflits des alliés de la France. Cette crainte n‘était pas vaine. L’interprétation tendancieuse donnée par la France à l’art. I6 du Covenant visait à utiliser notre territoire comme passage; pour attaquer l’Allemagne dans le cas où la grande République jugerait nécessaire d’agir pour secourir ses alliés. Cette thèse fut soutenue verbalement d’abord, ensuite par écrit dans les explications que nous fûmes amenés à demander à Paris, au sujet de déclaration particulièrement inquiétantes qui avaient été faites par de hautes personnalités militaires françaises. C’est la raison pour laquelle nous dénonçâmes les accords militaires, dans un échange de lettres présenté comme interprétatif le 6 mars 1636. Les dangers que nous redoutions s’étaient, en effet, singulièrement aggravés par la conclusion de l’alliance franco-russe, et la politique belliciste poursuivie par Moscou.
Même limité à une alliance purement défensive, un accord avec la France et l’Angleterre nous eut exposés à être impliqués dans toute guerre occidentale en raison du choix que nous faisons entre les deux groupes d’adversaires. Et dans quelles conditions désastreuses pour nous: depuis que l’Allemagne avait réoccupé militairement la Rhénanie, le choc devait nécessairement se produire en Belgique avec les ruines, les dévastations et les hécatombes inséparable de la lutte de ses formidables armées. Nous ne pouvions prendre un risque aussi mortel, car vainqueurs ou vaincus nous serions décimés et ruinés.
D’aucuns objecteront peut-être la lumière des derniers événements que cette éventualité était inévitable et que, dans ses conditions, mieux valait s’arranger quand même avec la France et l’Angleterre pour donner le maximum de chances à notre résistance ou tout au moins à la victoire des alliés, dont dépendrait notre salut.
Je répondrai tout d’abord que l’éventualité qui s’est produite n’était pas la seule qui put se produire. Nous avions des possibilités d’échapper au conflit: la Suisse et la Suède y sont restées étrangères, malgré l’extension européenne et ensuite mondiale des hostilités. Bous avons pu nous y soustraire pendant huit mois et mieux nous préparer, et ce résultat n’est pas un bénéfice négligeable. N’eussions-nous eu qu’une chance sur cent d’éviter la catastrophe, nous devions la courir, car avec l’alliance franco-anglaise, nous étions certains d’être en guerre; avec la neutralité, la chose restait douteuse. Nous ne pouvions jouer le sort de la Belgique sur un pari.
Le gouvernement de Bruxelles réussit d’ailleurs à faire comprendre sa situation à l’Angleterre et à la France; il obtint de ceux-ci le maintien de la garantie qu’ils avaient promise par le Pacte de Locarno et cela sans autre contrepartie que l’engagement de la Belgique de résister à toute attaque contre son territoire et de demeurer fidèle au principe du Covenant. Cette promesse fut actée dans les lettres que la France et l’Angleterre lui adressèrent le 24 avril 1937. La Belgique gardait tous les avantages de Locarno et se trouvait libérée de ses charges et ses charges et de ses dangers. Qu’eussions-nous pu souhaiter de plus avantageux?
Mais je vais plus loin. Eussions-nous été certains de la tournure qu’ont prise les événements, que nous n’aurions pu agir autrement que nous ne l’avons fait. Et cela pour des raisons à la fois d’ordre intérieur et d’ordre extérieur.
Raisons d’ordre intérieur. D’abord parce qu’on ne peut conclure d’alliances sans un large assentiment de l’opinion publique et que cette opinion était chez nous, dans sa très grande majorité, hostile à un accord avec la France. L’opposition qui s’était levée de plus en plus puissante dans le Pays contre l’accord militaire, en est la preuve éclatante. Nous fûmes obligés de dénoncer cet accord avant même la liquidation du Pacte rhénan. Croit-on qu’on eût pu le renouveler après la disparition de Locarno, alors que les risques étaient décuplés? C’eût été témoigner d’un singulier respect de la volonté populaire et je suis surpris de voir soutenir ce point de vue par des constitutionnalistes de la stricte observance.
Mais supposons un instant qu’un Gouvernement eût été assez audacieux pour le faire et assez adroit pour ne pas être renversé, songe-t-on sans effroi à la situation dans laquelle nous nous fussions trouvés au moment d’une guerre causé par une alliance conclue centre le sentiment public? Se rend-on compte que, le 3 septembre 1939, nous aurions dû, en même temps que la France et l’Angleterre, déclarer la guerre à l’Allemagne, alors que nous n’avions été en rien mêlés aux prémices du conflit? On n’affronte pas la plus terrible des épreuves à laquelle un peuple ait à faire face avec un pays divisé. Cette division nous eût nui d’ailleurs bien avant la guerre non seulement dans le domaine moral, mais dans le domaine de la préparation matérielle de la guerre.
La violation du Pacte de Locarno avait accéléré la course aux armements. Si la Belgique n’augmentait pas ses forces en proportion de celles des autres Etats, sa position s’affaiblirait dangereusement et elle serait incapable de faire face à une attaque. Renforcer sa défense était pour elle une nécessité actuelle et vitale. Or, le Parlement refusait les crédits parce que le Gouvernement était soupçonné d’une politique d’alliance défensive avec la France. A plus forte raison, n’aurait-on pu espérer obtenir des crédits du Parlement, si celui-ci avait su qu’ils devaient être octroyés pour appliquer une politique d’alliance offensive avec la République. Le seul moyen de constituer une majorité était de faire une politique qui ralliât tous les Belges sur les problèmes extérieurs. Seule la politique d’indépendance pouvait y réussir. Elle y a réussi en fait. Chose plus précieuse, elle a refait l’unité morale du Pays, condition inéluctable d’une défense sérieuse. Au point de vue intérieur, c’était non pas la solution la meilleure ou la moins mauvaise, c’était le seul possible. L’opinion publique et le Parlement n’ont pas caché leur sentiment à ce sujet. Ce qui rendait le problème plus angoissant en Belgique, c’était le caractère racial qu’avaient pris les discussions au sujet de l’alliance française. Les Flamands y étaient hostiles dans leur quasi-totalité; en Wallonie, bien que beaucoup de gens fussent partisans de la neutralité, des éléments assez nombreux penchaient vers la France par raison sentimentale, communauté de langue ou affinités philosophiques. Le conflit qui se serait produit en temps de guerre sur la question d’alliance menaçait d’opposer flamands et wallons et de déchirer le Pays. C’était là une raison plus que suffisante et même décisive pour revenir à la neutralité.
Mais les motifs d’ordre extérieur n’étaient pas moins impérieux pour recommander cette politique. Nous avons déjà signalé plus haut l’accroissement de risques qu’eût entraînés une alliance au point de vue diplomatique. Nous n’avons pas encore examiné quelles en eussent été les conséquences au point de vue militaire, politique et moral.
Les partisans de l’alliance affirment que celle-ci nous eût mis dans une position beaucoup plus favorable pour la défense du territoire. C’est là une affirmation purement gratuite et nous allons le démontrer.
Une défense efficace exigeait une augmentation de nos effectifs, de notre matériel et de nos fortifications. La France l’eût réclamé à bon droit. Croit-on que le Parlement l’eût consenti sous le régime de l’alliance? Nous venons de voir que non. Si la Belgique l’eût refusé et que la Franc eût offert d’y suppléer, en construisant un prolongement de la ligne Maginot en Belgique, encore eût-il fallu occuper ces travaux qui, non gardés, eussent constitué une tentation pour l’ennemi. A défaut de troupes belges, notoirement insuffisantes en nombre et en armement, eussions-nous accepté que les troupes françaises s’y installassent en temps de paix? Poser la question c’est la résoudre. La Belgique n’est pas mûre pour un protectorat, alors!
Admettons un instant que le Pays se fût converti à l’idée de l’alliance française et eût fait les sacrifices qu’elle comporte en effectifs, matériel, et fortifications, nous n’aurions pas encore disposé de forces suffisantes pour mettre e territoire à l’abri de l’invasion, sans le concours des troupes françaises en temps de paix.
Je vais plus loin encore. Excluant l’idée de cette occupation pacifique et de la vassalisation qui s’ensuit en acceptant le risque d’une invasion partielle du territoire par l’ennemi au début d’une guerre, aurions-nous pu, par une alliance, améliorer notre position stratégique dans la bataille qui se serait livrée en Belgique, et comment?
Les partisans de l’alliance répondent par un mot magique qu’ils croient décisif: les Accords Militaires. A préparation de la campane parles deux Etats-majors eût donné, disent-ils, à l’action de nos armées une coordination qui aurait assuré le succès. C’est l’absence de cette entente qui a causé tout le mal.
Depuis 1920 jusqu’en 1936, les Etats-majors belge et français ont entretenu des rapports étroits et étudié tous les plans de défense imaginables. Les fortifications belges étaient organisées en fonction de ces études et l’on peut affirmer que le problème n’a pas changé essentiellement depuis. Ces plans et ces arrangements mûris pendant seize ans se sont avérés inutiles, à quoi bon en faire d’autres? S’ils avaient été soigneusement préparés, que pouvait-on souhaiter de mieux?
Il faut tenir compte d’ailleurs, en ces matières, d'une vérité d'expérience. Les accords militaires les plus minutieusement arrêtés sont subordonnés aux événements de guerre et une grande Puissance ne les observe que dans la mesure où ils cadrent avec ses intérêts stratégiques du moment. Ne trouée à un point sensible de ses lignes l’obligera peut-être à détourner à son profit des effectifs qu’elle avait promis à son allié. L’intérêt de la bataille ou le succès de la guerre peut dépendre de cet accroc à des engagements pourtant très précis. Les accords militaires n’ont donc pas une valeur absolue. L’essentiel dans ces accords était l’étude de divers plans de défense qui ont permis d’harmoniser au mieux les actions communes. De ce côté, le nécessaire était fait dans ses grandes lignes depuis longtemps. Le reste a dû être complété au moment où l’attaque ennemie est devenue une certitude.
Du côté des accords d’Etats-majors, une alliance n’eût rien apporté de plus. Elle eût par contre, provoqué de très grands inconvénients d’ordre politique. Prendre parti à l’avance et se ranger dans un camp, c’est accepter tous les risques d’une défaite éventuelle. Le vainqueur n’aura aucune raison de nous ménager à la paix. Mais si, au lieu de nous allier à un camp, nous ne faisons que repousser une attaque, la situation devient toute autre. Nous avons pour nous l droit et ce n’est pas toujours un vain mot. Le prestige de la Belgique en 1914 et sa force morale ont tenu à cette attitude.
Les leçons de la guerre ont-elles démenti nos prévisions et donné tort à notre prudence? Bien au contraire. Tout ce que nous savions de l’impréparation des alliés et de la puissance formidable de l’Allemagne s’est vérifié au-delà de nous craintes. Deux faits principaux sont à relever pour éclairer le débat: l’un avant, l’autre pendant les hostilités.
Le premier se rapporte à la suggestion qui nous fut faite notamment le 9 avril 1940, par les Français et les Anglais, de laisser entrer leurs troupes en Belgique avant l’attaque l’allemande. On nous assurait qui si nous acceptions, les Alliés seraient en mesure de mieux nous défendre. Voulant peser les avantages et les inconvénients de cette proposition, nous demandâmes jusqu’où les forces alliées pourraient se porter. On nous répondit: jusqu’à la ligne K[oningshooikt].-W[aver]., c’est-à-dire Anvers-Namur. Donc même en acceptant, avec ses graves dangers politiques, une entrée anticipée des franco-anglais en Belgique, ceux-ci n’auraient pu aller au-delà de notre deuxième ligne de défense. La moitié du Pays était livrée à l’invasion allemande, le reste à la destruction. On comprend que le Conseil des Ministres repoussa sans hésiter cette suggestion.
Deuxième fait pendant les hostilités. Que montre le déroulement de la guerre? Ce n’est pas en Belgique que c’est produit l’événement décisif de la défaite, c’est en France, à Sedan. C’est la percée de Sedan qui a forcé les Belges et les Alliés, à reculer pour ne pas être tournés. Encore la rapidité de l’effondrement français n’a-t-elle pas permis de rabattre en temps voulu les forces alliées vers la France. La seconde percée s’est produite, encore en France, du côté d’Abbeville, coupant en deux tronçons les armées alliées anglo-franco-belges. La Belgique n’a donc aucune responsabilité ans le désastre. On doit même constater que ce sont les armées du Nord qui se sont le mieux battues; se repliant en bon ordre jusqu’à la mer, alors que les forces françaises étaient disloquées. La leçon de la guerre, loin de condamner la politique belge n’a fait que la justifier. Une prolongation de la lutte dans notre Pays était impossible et n’eût modifié, d’ailleurs en rien, le résultat final.
Après avoir étudié les circonstances qui commandaient et justifiaient la politique d’indépendance, voyons ceux qui en ont pris la responsabilité. Le Roi est le premier qui en ait conseillé l’adoption.
Et comment a-t-il fait? Au cours d’un Conseil où Il a lu à ses Ministres un Mémoire qui résumait les raisons de cette politique dans des termes si justes et si convaincantes que les Ministres, à l’initiative de M. Vandervelde, se rallièrent immédiatement aux vues du Souverain et le prièrent de rendre ce mémoire public. Le Roi écrivît au Premier Ministre que, déférant à ce désir, Il autorisait la publication. Celle-ci fut effectuée par les soins de M. van Zeeland, qui, par le fait, engageait la responsabilité du Gouvernement. L’opinion et le Parlement partagèrent, dans leur immense majorité, le sentiment du Roi et de Ses Ministres et continuèrent cette approbation jusqu’à la guerre. Que peut-on reprocher au Roi en cette matière? Il avait incontestablement le droit de conseiller Ses Ministres. Il aurait même eu le droit de parler au Pays s’Il jugeait bon. Il ne l’a fait que sur les instances unanimes de Ses Ministres et sous leur contreseing. Rien de plus constitutionnel. Le Pays tout entier L’a approuvé. Si une erreur de jugement avait été commise en l’occurrence, ce serait celle de tous les Ministres, de tous les Partis et de tout le Pays. Comment et de quel droit ceux-ci oseraient-ils le reprocher au Roi?
Je sais que certains diront: l’unanimité du début ne s’est pas entièrement maintenue, il eût fallu réviser cette politique.
Nous répondrons que la très grande majoritédu Pays lui restait fidèle et que par conséquent, il n’y avait pas lieu de la changer, et cela d’autant moins que les événements extérieurs devenaient plus graves. Nous ajouterons que parmi les opposants, il y avait deux catégories de personnes. Les uns partisans de l’alliance française, dont le Pays ne voulait pas, les autres mûs par des idéologies révolutionnaires, comme M. Vandervelde, qui regrettait de ne pouvoir embarquer la Belgique et l’Europe dans une croisade pour l’Espagne rouge. Cela aussi le Pays ne voulait pas. D’ailleurs, parmi ces opposants, il est juste de rappeler que les plus importants abjurèrent leur erreur à l’approche du danger. En septembre 1939, M. Vandervelde vint assurer M. Spaak qu’il se ralliait sans réserve à la politique d’indépendance.
Nous croyons de devoir rappeler les adversaires du Roi et de la politique d’indépendance à plus de justice et à un sens plus exact des proportions. En supposant-ce qui n’est pas le cas - que la Belgique eût commis une erreur en restant neutre, l’importance du facteur belge n‘était pas de nature à bouleverser le sort de l’Europe et changer le destin des batailles. N’imitons pas la prétention ridicule de la grenouille qui voulut se faire aussi grosse que le bœuf. A l’étranger, tant chez les neutres que chez les alliés, on rend aujourd’hui hommage à notre attitude et l’on fait même amende honorable au Roi. Ne soyons pas moins équitables qu’à l’étranger.
Un dernier mot. Nous nous sommes attachés, dans cette courte Note à justifier la politique suivie par le Pays depuis 1936 jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Nous avons surtout souligné les circonstances de temps et de lieu qui la commandaient. Mais en nous élevant plus haut que les contingences actuelles, il faut reconnaître que cette politique s’inspire des principes qui s’imposent à un petit pays vivant dans une situation géographique particulièrement exposée comme la nôtre. Aussi, l’histoire de la Belgique montre-t-elle, qu’en dehors des périodes de crise où nous avons dû, bon gré, mal gré, nous mêler aux querelles des grands voisins, nos dirigeants sont toujours revenus, quand ils en étaient libres, à la tradition de neutralité qui est l’intérêt suprême des petits Etats, qui n’ont rien à gagner et tout à perdre aux lutes des grandes Puissances.
L’avenir peut réserver encore beaucoup de vicissitudes à notre Patrie: nous sommes un fort petit pion sur le grand échiquier mondial. La nouvelle carte du globe sera sans doute tracée en dehors de nos avis et désirs. N’oublions pas cependant que toute alliance avec les grands diminue non seulement la liberté de notre action extérieure, mais aussi le libre épanouissement de notre personnalité intérieure. Tâchons de préserver celle-ci de notre mieux et ne donnons pas de notre propre gré les mains à une vassalisation du pays. Pensons, non pas en fonction des influences mouvantes du présent, mais en fonction des lois séculaires de notre histoire. Restons Belges avant tout, gardons jalousement le trésor des traditions léguées par les ancêtres et qui ont rendu glorieux le nom belge dans les Annales de l’humanité.
3. Schelde-dossier
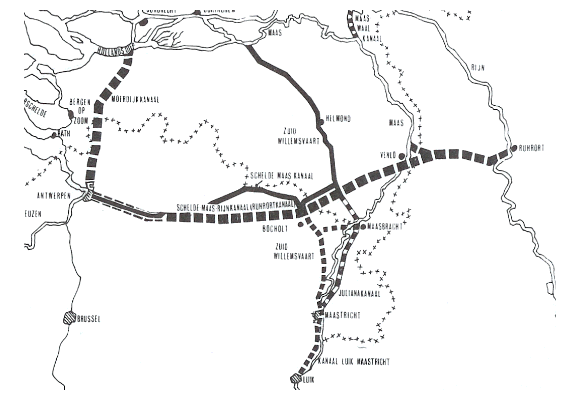
Het oorspronkelijke plan zoals
vooropgesteld in het Verdrag van 1925. Linksbovenaan het Moerdijk-kanaal
en
centraal het Albert-kanaal dat Antwerpen met Ruhrort moest verbinden.[1061]
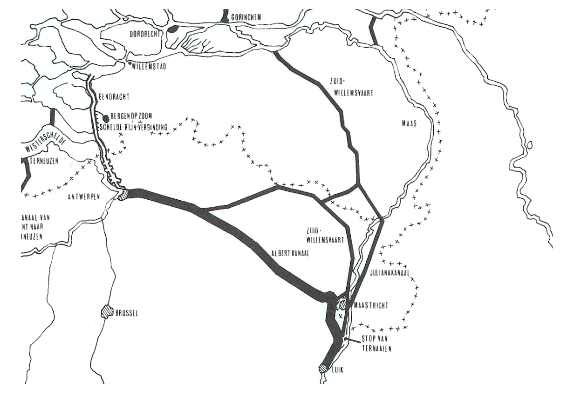
Zoals het er uiteindelijk in 1963 zou uitzien. Het Moerdijk-kanaal werd Westelijker aangelegd dan voorzien en het Albert-kanaal sterk Zuid-oostelijk afgebogen. Van het oorspronkelijke plan om het kanaal in rechte lijn met Ruhrort te verbinden werd dus fel afgezwakt.[1062]
| home | lijst scripties | inhoud | vorige | volgende |
[1058] SOMA CA 1277/1 , Baron van Zuylen.
[1059] SOMA CA 1086, Burggraaf Jacques Davignon.
[1060] Ahin, Manuscript P. van Zuylen. Le Roi et la Politique d’indépendance.
[1061] SCHUURSMA, Het onaannemelijk tractaat, 53.
[1062] SCHUURSMA, Het onaannemelijk tractaat, 260.